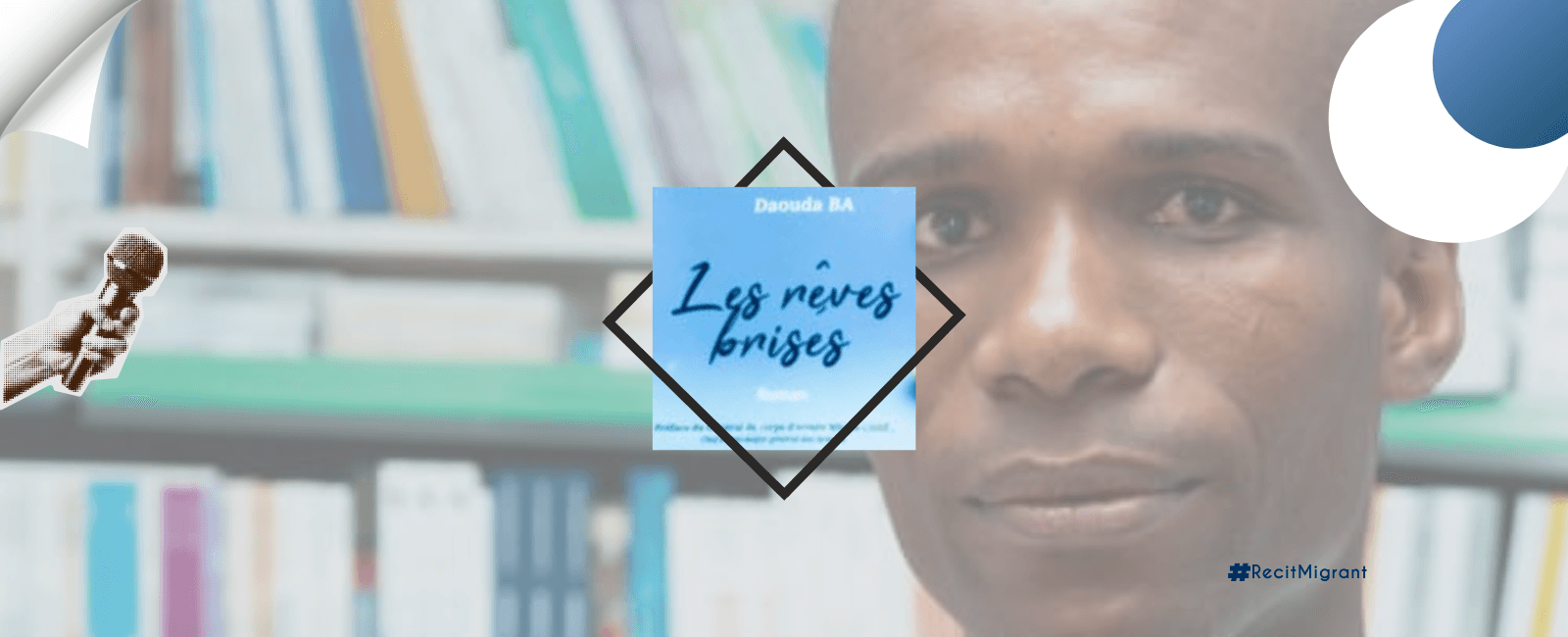
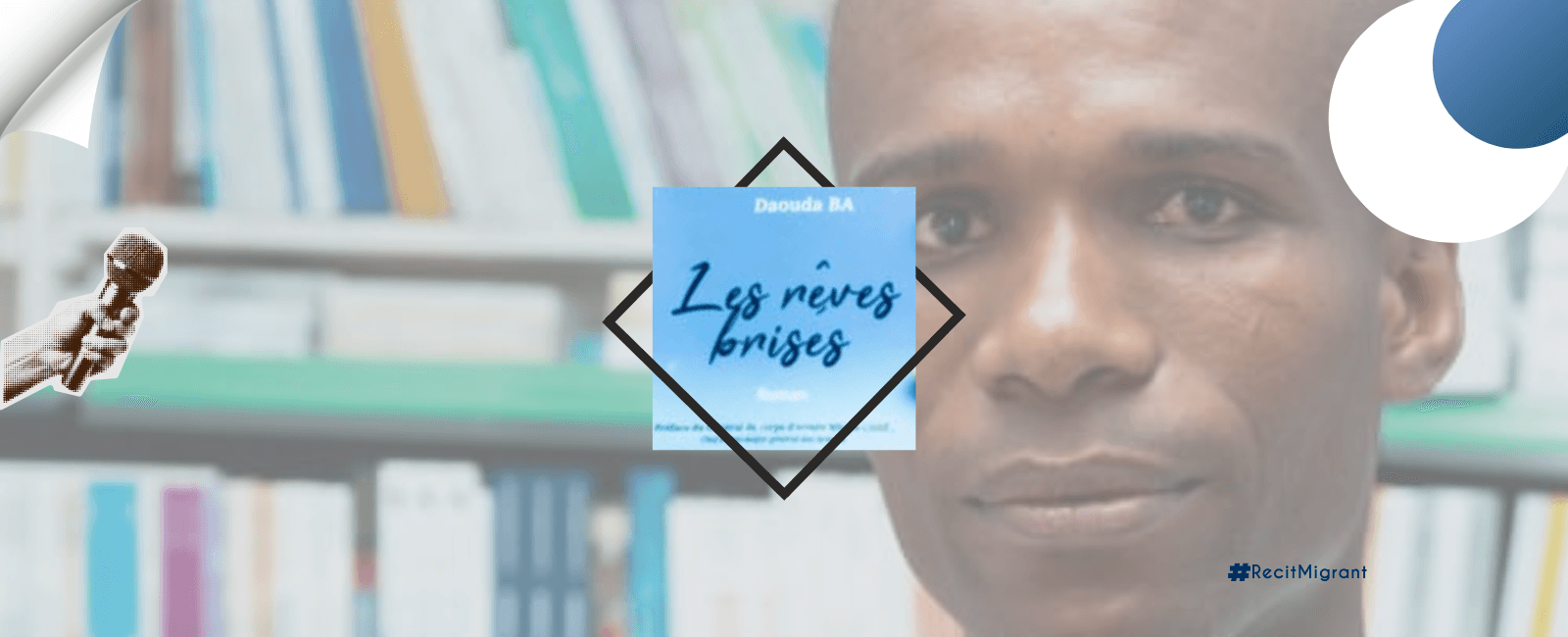
Entre récit et témoignage, l’ouvrage « Les Rêves Brisés » du journaliste Daouda BA met au jour le prix humain de l’émigration irrégulière. Des jeunes aspirants à un avenir meilleur, des mères qui perdent leurs fils, et une société confrontée à la santé mentale et à la précarité. Une invitation à regarder au-delà du mirage du départ.
Qu’est-ce qui vous a poussé à écrire sur la migration irrégulière et les drames qui en découlent dans les côtes sénégalaises ?
« Les Rêves Brisés » met en lumière les difficultés que traversent aujourd’hui les jeunes africains, sénégalais en particulier et du monde entier en en général, marqué par des crises multiformes. D’une part, c’est l’émigration irrégulière avec son cortège macabre. Des jeunes pétris de talents, mais en perte de perspectives pour ne pas dire d’avenir dans leurs propres pays, bravent l’océan Atlantique ou empruntent la voie terrestre le long des frontières pour rejoindre l’Europe, au péril de leur vie avec l’espoir de trouver un lendemain meilleur ailleurs. Malheureusement, le plus souvent cette aventure est soldée par un échec parce que la plupart des candidats perd la vie lors de ce périlleux périple. Une situation dramatique qui appelle à un engagement collectif pour freiner ce fléau. Voilà en quelque sorte l’idée qui nous a motivée à écrire ce livre pour participer à la lutte contre l’émigration irrégulière non seulement par dénonciation mais aussi à travers la sensibilisation et la proposition des pistes de solutions.
Comment avez-vous choisi le titre “Les Rêves Brisés” et quel sens porte-t-il dans votre travail de terrain et vos recherches ?
« Les Rêves Brisés » met en lumière un ensemble d’ambitions et d’expériences soldé par des échecs. Chacun des personnages du livre s’est fixé une ambition mais à terme il n’arrivera pas à ses rêves. D’abord, le père Bécaye qui a abandonné l’activité agricole pour se tourner vers la pêche. Parce qu’il ne tirait pas bénéfice de ses récoltes, qui par faute d’espace de conditionnement [chambre froide], et des pistes de désenclavement pour l’écoulement dans les marchés, pourrissent. Mais malheureusement, l’activité de la pêche aussi était confrontée à des crises multiformes notamment la raréfaction de la ressource halieutique et l’exploitation abusive… Ensuite, Abdou et Amar, deux jeunes frères, fils uniques de leur mère Soukeina (épouse de leur père Bécaye), rêvaient de réussir leur vie et de sortir leurs parents de la pauvreté. Malheureusement, ils ont perdu la vie dans l’océan Atlantique, victimes de l’émigration irrégulière alors qu’ils tentaient de rejoindre l’Europe. Mère Soukeina qui rêvait de voir ses deux fils uniques réussir leurs vies, les a perdus dans des circonstances troubles. Espérant retrouver les corps de ses enfants ne serait-ce que pour observer le deuil, elle n’y arrivera pas parce qu’ils sont engloutis par l’Atlantique. Un lourd fardeau qu’elle va porter jusqu’à mettre un terme à sa vie après avoir longtemps combattu contre la schizophrénie… Ce sont des rêves brisés parce que tout simplement ils n’arrivent pas au bout de leurs objectifs d’où le titre du roman : « Les Rêves Brisés ».
Abdou et Amar apparaissent comme des figures centrales. Comment avez-vous raconté leurs histoires et quelles précautions avez-vous prises pour les traiter avec respect ?
Abdou et Amar, sont à l’image de ces plusieurs milliers d’inconnus, hommes, femmes et enfants, engloutis dans les eaux froides de l’Atlantique ou encore disparus dans le désert du Sahara occidental…, sur les routes de l’émigration irrégulière. Deux jeunes frères uniques à leur mère Soukeina.
Abdou, est un véritable missionnaire qui s’est fixé dès le bas-âge comme objectif de devenir le plus grand intellectuel de sa famille et faire sortir ses parents de la pauvreté dans laquelle ils vivaient depuis longtemps. Après son premier diplôme universitaire en poche, il est orienté à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il obtient sa licence et est sélectionné pour le Master. Mais les cours tardent à commencer. Il quitte l’université et retourne chez sa famille à Saint-Louis. Abdou retrouve son frère Amar qui s’était fixé comme objectif de devenir un grand pêcheur disposant de plusieurs pirogues. C’est là qu’ils vont prendre une pirogue héritée de leur père Bécaye pour aller en suite. Mais en réalité, ils tentaient l’émigration irrégulière qui malheureusement va mal tourner…
Pouvez-vous partager une scène ou un témoignage marquant qui résume, selon vous, l’ampleur des défis rencontrés par les familles des migrants ?
La maladie de mère Soukeina appelée “schizophrénie” en est une parfaite illustration. Une mère de famille qui a perdu ses fils uniques dans les conditions précitées s’est retrouvée avec une maladie qui l’a amenée à mettre fin à sa vie. Cela dit qu’aujourd’hui, beaucoup de mères de famille sénégalaises ou africaines incarnées ici par Soukeina, femmes au foyer impécunieuses, recrues d’épreuves et dont les rêves tenaces sont souvent brisés par le ressac des échecs de leurs progénitures. Une situation dramatique et déplorable qui résume aujourd’hui le calvaire vécu par les familles des migrants.
Vous mentionnez dans l’ouvrage la sécurité des migrants, notamment l’argent des migrants capturés qui aident à financer le terrorisme en Afrique. Selon vous, dans quelle mesure une approche continentale et coopérative est-elle nécessaire pour contrer les réseaux criminels et protéger les migrants ?
Au-delà de la voie maritime, la migration par la voie terrestre reste préoccupante et constitue un véritable défi sécuritaire pour les pays africains, notamment le Sahel et l’Afrique de l’Ouest. Le trafic humain le long des frontières participe aujourd’hui au développement du banditisme organisé, le terrorisme notamment. Et dans le livre, j’ai expliqué au Chapitre 7, comment aujourd’hui, les flux migratoires sont devenus les principales sources de financement des réseaux de criminels et de groupes terroristes en Afrique et dans le Sahel. Cela dit que pour lutter contre le terrorisme, il est impératif de commencer par la migration le long des frontières terrestres. Ce qui rappelle l’impérieuse nécessité de sévir dans une unité d’actions et de politiques dans toute la région Afrique, notamment dans les sous-régions Afrique de l’Ouest et du Nord, qui abritent principalement le plus grand nombre de flux migratoires. En plus de cela, renforcer la coopération entre les États sur le plan sécuritaire.
Toujours dans le livre, vous évoquez la raréfaction des ressources halieutiques au Sénégal, comment cette raréfaction contribue-t-elle à alimenter les flux migratoires ?
Dans cette partie du livre exactement, j’ai voulu montrer le rapport qui existe entre la raréfaction des ressources halieutiques née de l’exploitation abusive de la mer et l’émigration irrégulière. Aujourd’hui, dans les zones de pêche sénégalaises, les acteurs dépensent beaucoup d’argent en termes d’essence de pirogues pour aller pêcher mais au retour, ils ne gagnent plus rien. Autrement dit, ils ne recouvrent pas les montants dépensés pour acheter du carburant. Ce qui fait que le plus souvent certains de ces acteurs se tournent vers le convoyage des migrants en complicité avec les organisateurs des voyages irréguliers. Cela dit que l’État a la lourde responsabilité de mettre fin à cette pratique malsaine de l’exploitation abusive des ressources par des bateaux étrangers qui parfois utilisent des sociétés écrans ou des prête-noms à faible capital, pour lutter contre l’émigration irrégulière et la précarité dans les zones de pêche sénégalaises. C’est le lieu d’encourager et de féliciter les nouvelles autorités sénégalaises pour toutes ces mesures prises allant dans le sens d’harmoniser le secteur de la pêche pour un développement durable. Je pense qu’il est impératif aujourd’hui d’accompagner les acteurs du secteur de la pêche pour l’acquisition de matériels modernes qui aideraient à pratiquer une pêche durable tout en protégeant la ressource, en plus de l’acquisition des licences de pêche.
Vous rendez également hommage à ces femmes qui se battent pour nourrir leurs enfants. Selon vous quelles sont les plus grandes difficultés rencontrées par ces mères et épouses dans le contexte de la migration irrégulière ?
Effectivement, dès le début de l’ouvrage, j’ai voulu rendre hommage aux femmes en ces termes : « Hommage à toutes ces mères qui se battent au quotidien pour trouver de quoi nourrir leurs enfants… ». La plus grande difficulté rencontrée par ces mères de famille, incarnée dans le livre par la personne de mère Soukeina, c’est l’assistance psycho-sociale. Parce que la plupart de ces mères de famille participent souvent au projet de voyage de leur enfant en finançant même le voyage, sans se soucier des conséquences. Et si le projet échoue, elles deviennent victimes collatérales. L’autre élément important qu’il ne faut pas négliger, c’est la problématique de l’autonomisation des femmes dans certaines zones du pays, ce qui qui participe parfois à rendre les vulnérables.
Comment le livre aborde-t-il les questions de santé mentale et les pressions sociales autour des femmes touchées par la migration ?
A travers la personne de mère Soukeina qui a perdu ses deux fils uniques dans l’Atlantique, j’ai voulu montrer les conséquences sociales de l’émigration dans la société. L’exemple de mère Soukeina, atteinte de la schizophrénie, met un terme à sa vie. Cela dit que les conséquences sont diverses. Elles peuvent être psychologiques, économiques, etc.
Mère Soukeina, atteinte de schizophrénie et suicidaire, est un personnage poignant. Comment avez-vous abordé ce sujet avec sensibilité et sans stigmatisation ?
C’est la puissance du genre romanesque, qui est une œuvre de fiction qui raconte une histoire inventée avec des personnages, des intrigues et des thèmes qui visent à refléter la réalité humaine, la société ou l’expérience individuelle. Et à travers ce livre on a allié la fiction et la réalité pour pouvoir faire passer le message avec des personnages bien choisis et des rôles bien déterminés. C’est le même cas avec le personnage incarné par Mère Soukeina.
À la lumière de votre travail, quelles politiques publiques seraient les plus urgentes à adapter ou à mettre en place pour lutter contre l’exploitation et améliorer les conditions de vie ?
Des politiques adoptées aux besoins et attentes des jeunes. Parce qu’on a l’impression que les jeunes ne se retrouvent pas dans les politiques et programmes mis en place par les gouvernements africains. Le constat est que malgré les initiatives en leur faveur, les jeunes continuent de tourner le dos à ces politiques et programmes pour se lancer dans l’émigration irrégulière au péril de leur vie. Ce qui veut dire qu’il faudrait une évaluation rigoureuse de ces programmes pour une meilleure implication des jeunes dans l’élaboration et l’exécution des politiques et programmes qui leurs sont dédiés.
Quels conseils donneriez-vous aux jeunes qui envisagent de partir en migration irrégulière ?
Le conseil, c’est de dire aux jeunes d’user des voies légales pour voyager pour ceux qui le veulent vraiment. Parce que l’émigration en tant que telle n’est pas un fardeau. C’est un droit reconnu à tout citoyen. L’article 12 de la Charte Africaine des droits de l’Homme et des Peuples (CAHDP) stipule que : « Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l’objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques ». Donc, chacun a, le libre choix de voyager ou de rester au pays, mais l’essentiel c’est d’user des voies légales pour voyager. Inviter aussi les gouvernements africains, les ambassades européennes établies en Afrique, de revoir en commun, les politiques d’accès aux visas.


