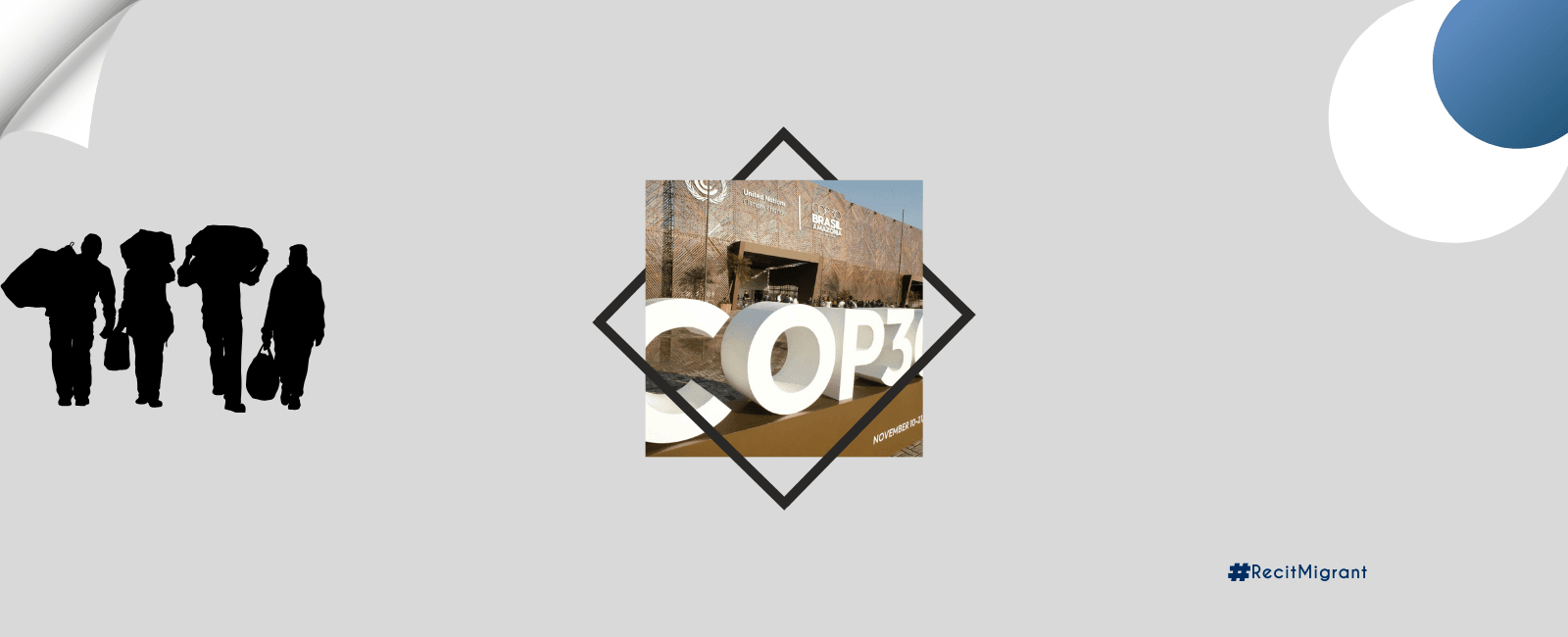
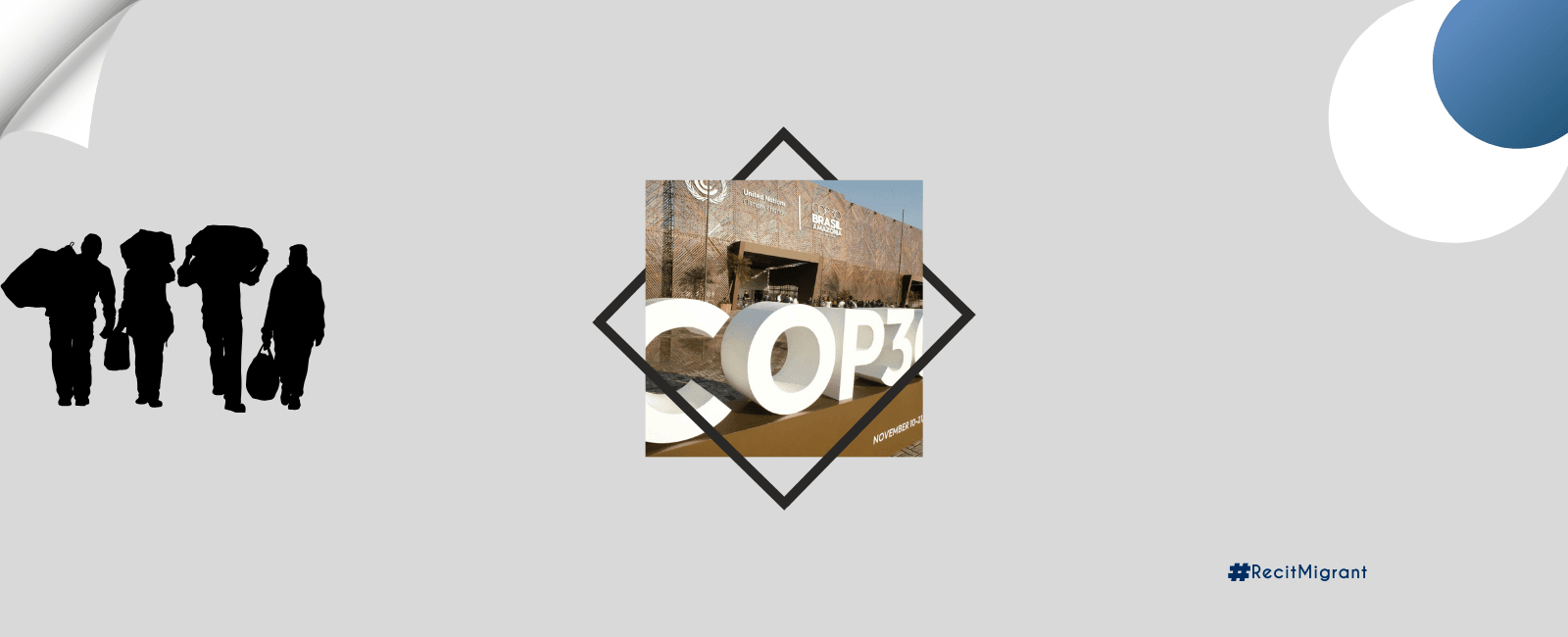
Les rideaux sont tombés pour la COP30 à Belém, au Brésil. Ce qui marque encore une fois un paradoxe devenu presque structurel dans les négociations climatiques : on y parle d’émissions, de financements, la réduction des gaz à effet de serre, l’adaptation, la protection des écosystèmes, de pertes et dommages, de feuilles de route énergétiques mais rarement de migrations humaines, pourtant l’une des conséquences les plus directes, les plus visibles et les plus humaines du dérèglement climatique. Cette absence est frappante, d’autant que sécheresses, inondations, événements extrêmes et effondrements agricoles façonnent déjà des mouvements de populations à grande échelle.
Les migrations humaines, même lorsqu’elles sont causées par les sécheresses ou la dégradation des terres, ne font pas partie du cœur juridique du processus.
Résultat : on traite les causes (climat), mais pas les conséquences humaines (déplacements). Cette structure historique enferme la discussion dans un cadre technique, scientifique et financier et non social.
Pourtant, la migration est déjà le cœur humain de la crise climatique
Choisir l’Amazonie comme épicentre de la COP30 place le paradoxe au cœur du débat : la région est simultanément un acteur clé de la résilience climatique mondiale et une zone menacée par les pressions humaines et environnementales. Pour les populations autochtones et les communautés rurales, la mobilité n’est pas qu’un enjeu d’échelle géographique; elle touche aux droits territoriaux, à la préservation des cultures et à la justice sociale. Reconnaître ces dynamiques, c’est réinventer l’action climatique comme une politique qui place les personnes au centre, et non comme un simple indicateur d’impact environnemental. Les peuples autochtones menacés par la déforestation et la dégradation des terres, les agriculteurs qui ne peuvent plus vivre de leurs terres. Les riverains de zones côtières confrontés à la montée des eaux et les urbains poussés à migrer après des catastrophes répétées.
L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) rappelle qu’en 2024, les catastrophes climatiques ont forcé 45 millions de personnes à se déplacer à l’intérieur de leur pays et ont généré plus de 240 milliards de dollars de pertes. Chiffres qui dépassent la simple statistique: ce sont des familles qui perdent leur foyer, des enfants dont l’école disparaît, des communautés qui doivent repenser leurs routes vers la sécurité et la dignité.
Des rapports et projections internationaux, comme ceux de l’OIM et de la Banque mondiale, offrent un cadre prospectif utile pour comprendre l’ampleur et la localisation des mouvements. Par exemple, les scénarios mondiaux prévoient une plage très large de migrations internes liées au climat, dépendant fortement des trajectoires d’émissions et des réponses politiques. En Afrique subsaharienne et dans d’autres régions, les villes intermédiaires jouent un rôle clé comme pôles d’attractivité potentiels, tout en restant vulnérables face à la complexité des politiques publiques et des pressions climatiques. Ces analyses soulignent l’importance d’un cadre global, tout en restant attentifs aux réalités locales et culturelles des communautés en mouvement.
Placer les personnes au cœur des décisions climatiques implique de les considérer comme des acteurs du changement et non comme des victimes passives. Cette posture permet de réduire les déplacements forcés, de protéger les plus vulnérables et de bâtir une réponse globale fondée sur la solidarité, l’inclusion et le respect des droits humains. L’idée est d’intégrer la mobilité humaine dans les plans nationaux et internationaux, afin d’adresser simultanément les défis climatiques et les dynamiques migratoires. Pourtant, l’un des résultats majeurs attendus de ce sommet était l’adoption d’un objectif mondial pour l’adaptation, destiné à : améliorer les systèmes d’alerte précoce, renforcer les moyens de subsistance, sécuriser les logements, réduire les migrations forcées liées au climat. Ces priorités sont au cœur des interventions de l’OIM, qui a soutenu en 2024 plus de 875 000 personnes et 100 000 communautés touchées par des catastrophes environnementales.
La migration climatique est politiquement explosive
Depuis les années 1980, la question des déplacements forcés liés au climat progresse sans que l’on dispose d’une définition juridique précise des « personnes fuyant leur pays pour des raisons climatiques ». Bien que le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (Pacte de Marrakech), adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2018, évoque les effets des changements environnementaux, son caractère non contraignant limite sa portée.
L’expression « réfugié climatique » désigne une personne contrainte de se déplacer en raison d’une catastrophe climatique ou, plus largement, du réchauffement climatique qui affecte son lieu de vie. Elle peut s’inscrire dans une catégorie plus vaste : les « réfugiés environnementaux ». Un rapport du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) de 1985 définit ces derniers comme des individus forcés de quitter temporairement ou définitivement leur habitat en raison d’un bouleversement environnemental (d’origine naturelle ou humaine) qui menace leur existence ou compromet gravement leur qualité de vie.
La plupart des migrations liées au climat sont internes au pays, et non des déplacements transfrontaliers. Pour illustrer, un rapport de la Banque mondiale (2021) prévoit environ 216 millions de personnes privées de leurs moyens de subsistance internes d’ici 2050 en raison de mouvements internes liés au climat et à la dégradation de l’environnement. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) préfère donc parler de « personnes déplacées par les catastrophes naturelles et le changement climatique » plutôt que de « réfugiés climatiques ».
Si les migrations liées à des transformations environnementales ne sont pas nouvelles, leur nombre ne cesse d’augmenter en raison de l’intensification des phénomènes climatiques extrêmes. Parmi les régions à risque, on peut citer : l’Afrique subsaharienne, confrontée à la sécheresse; l’Asie du Sud et du Sud-Est, exposée aux typhons et aux tsunamis et les petits États insulaires, face à la montée du niveau des mers. Selon une mise à jour publiée en 2025 par la fondation Bosch, ces migrations toucheront d’abord les villes, qui devront absorber à elles seules la majorité des mobilités internes.
Dans son dernier rapport (AR6), le GIEC souligne que la migration peut constituer un véritable outil d’adaptation lorsqu’elle est anticipée, accompagnée et choisie. En revanche, lorsqu’elle devient contrainte, elle se transforme en facteur de vulnérabilité et de risque. Depuis 2015, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) dispose d’une division dédiée à la migration, à l’environnement et au changement climatique (MECC), qui supervise, soutient et coordonne les initiatives liées aux migrations résultant du réchauffement climatique.
Selon une estimation de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), le stress hydrique pourrait délocaliser 700 millions de personnes en Afrique d’ici 2030. Les projections du rapport de World Disaster Report 2020 suggèrent qu’à l’horizon 2050, environ 200 millions de personnes par an pourraient nécessiter une aide humanitaire en raison des effets combinés des catastrophes liées au climat et de l’impact socio-économique du changement climatique. Le changement climatique exacerbe les défis existants et les vulnérabilités sous-jacentes, obligeant les communautés à faire face à des crises croissantes.
Selon de multiples sources, les Petits États insulaires en développement (PEID) font face à une menace existentielle due à la montée du niveau des mers et sont fortement touchés par les cyclones tropicaux, entraînant environ 7,5 millions de déplacements l’an dernier. La région Asie-Pacifique porte un lourd fardeau des effets néfastes du changement climatique: rien qu’en 2022, elle a connu plus de 140 catastrophes, faisant plus de 7 500 décès, touchant plus de 64 millions de personnes et causant des dégâts économiques estimés à plus de 57 milliards de dollars. Parmi les pays les plus touchés par le changement climatique, environ soixante-dix pour cent se situent parmi les plus vulnérables du monde. La tempête Daniel a ravagé la Méditerranée au début de septembre, provoquant une perte de vie et plus de 40 000 déplacés en Libye seule. Les communautés déplacées au Pakistan se remettaient encore des inondations de la mousson de 2022 lorsque de fortes pluies ont frappé à nouveau en juin 2023.
Reconnaître officiellement que le changement climatique provoque des déplacements massifs de personnes aurait plusieurs implications très sensibles :
- Créer un statut juridique de « réfugié climatique » : cela ouvrirait des droits nouveaux, que de nombreux pays développés sont réticents à assumer par peur : d’un précédent juridique, d’une responsabilité morale, d’un devoir d’accueil plus affirmé.
- Admettre une dette climatique plus lourde : si les déplacés du climat existent, cela signifie que certains États historiquement responsables des émissions ont une responsabilité directe sur ces déplacements.
- Redéfinir les frontières de la souveraineté : les migrations touchent à la politique intérieure, au contrôle des frontières, à l’intégration :
autant de domaines où les États veulent garder un contrôle total, loin du cadre multilatéral.
Le paradoxe est donc profond : la crise climatique est aussi une crise humaine, mais elle est traitée comme une crise technique. Ce qu’il manque : un pilier « mobilité humaine » dans les négociations. Si l’on prend au sérieux les projections des scientifiques, il est indispensable que les prochaines COP intègrent : une reconnaissance officielle des déplacés climatiques : aujourd’hui, ils n’existent pas juridiquement. Un financement pour soutenir les régions de départ et les lieux d’accueil : les villes qui reçoivent ces populations sont souvent les plus pauvres. Un cadre international de protection : pas pour forcer l’accueil, mais pour organiser une mobilité digne et humaine. Une vision long terme de l’habitabilité des territoires : certaines zones du monde deviendront trop chaudes pour y vivre.
Si les prochaines COP veulent réellement répondre à la crise climatique, elles devront élargir leur horizon : du carbone… aux vies humaines qui en subissent les conséquences.


