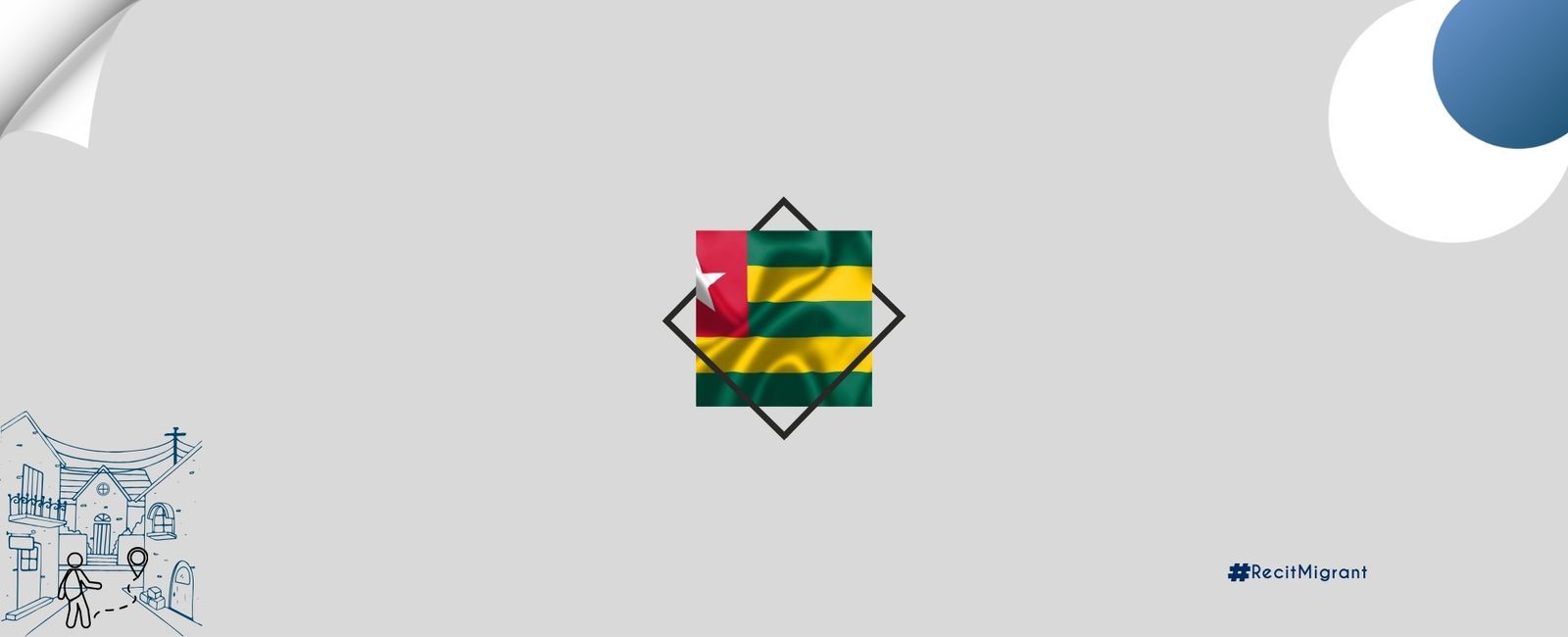
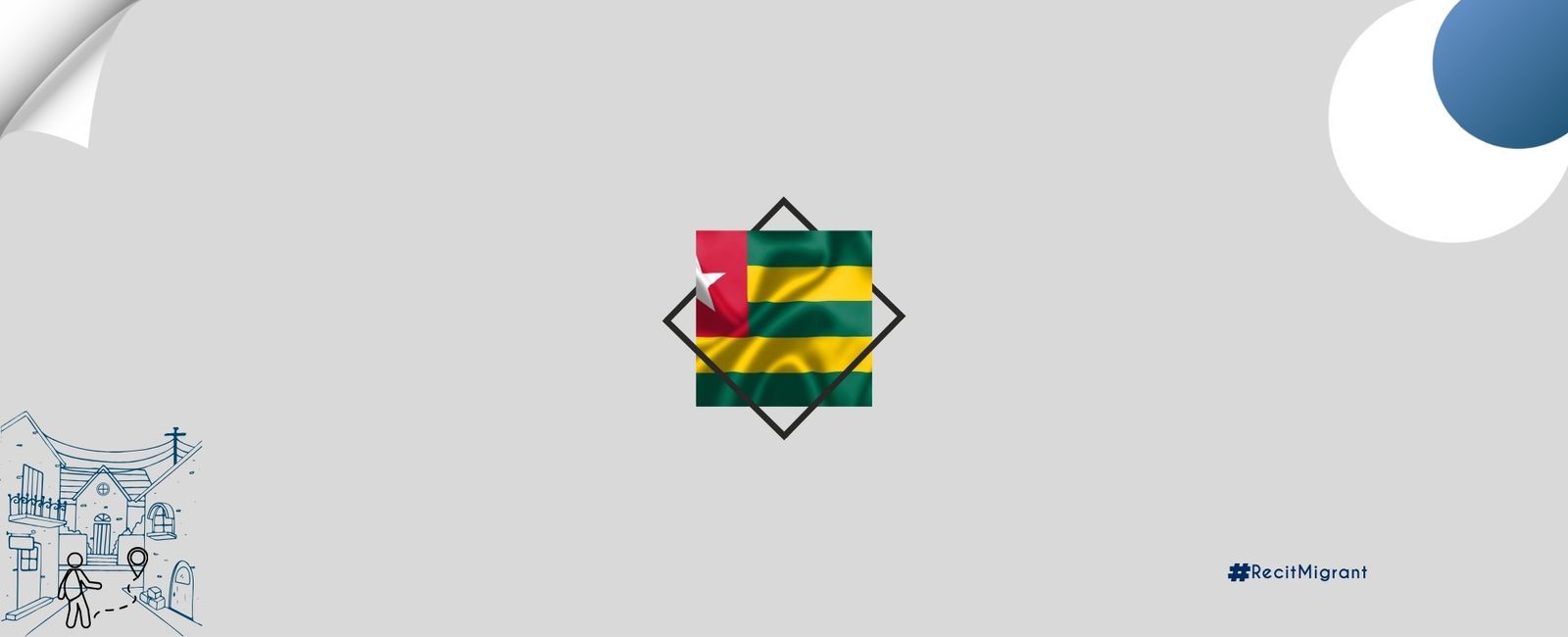
Lomé change vite. Entre 2010 et 2022, la population de l’agglomération du Grand Lomé est passée d’environ 1,57 million à plus de 2,1 millions d’habitants, soit une croissance annuelle soutenue (≈2,5–3 %). Cette montée démographique, alimentée par un exode rural continu et des migrations internes, exerce une pression forte et multidimensionnelle sur le logement, les transports, l’assainissement, la santé et l’emploi.
Lomé attire pour trois raisons principales qui sont entre autres, la recherche d’emploi et d’opportunités économiques (marché, port, services), l’accès aux services (santé, éducation, administrations) perçu comme meilleur qu’en zone rurale, et l’effet d’agglomération : présence d’un réseau diasporique et d’information favorisant la migration vers la capitale.
Le phénomène n’est pas propre au Togo. L’urbanisation en Afrique de l’Ouest suit une tendance comparable. Les villes concentrent emplois formels et informels et investissent davantage en infrastructures, ce qui attire des populations rurales en quête d’un meilleur revenu ou de services. Les projections indiquent que le Togo pourrait atteindre la parité urbain/rural dans les prochaines décennies si le rythme se maintient.
Pression sur le logement : informalité et étalement
La demande de logements dépasse l’offre formelle. Ainsi, on dénombre la multiplication des habitats informels et bidonvilles en périphérie ; la hausse des loyers dans les quartiers centraux ; et les conflits fonciers et occupation non planifiée d’espaces vulnérables (zones inondables, berges).
Le Plan National de Développement, la feuille gouvernementale 2020-2025 et les schémas directeurs prévoient le développement de logements sociaux et la mise à jour des plans d’urbanisme, mais la mise en œuvre reste un défi face à la rapidité des arrivées et aux contraintes foncières. Le gouvernement travaille à un nouveau Schéma Directeur d’Aménagement pour le Grand Lomé.
Transports et mobilité : embouteillages, motos-taxis et SUMP
La congestion routière et la croissance du parc de véhicules, surtout de mototaxis, pèsent lourd sur la mobilité. Les pertes de temps, la pollution et l’insécurité routière sont des conséquences récurrentes qui affectent l’économie urbaine. Pour y répondre, Lomé élabore un Plan de Mobilité Urbaine Durable (SUMP), une initiative qui vise à mieux planifier les transports, améliorer la sécurité routière et optimiser les services publics de transport. Le diagnostic mené dans le cadre de ce plan a permis de tracer des priorités et de renforcer les capacités institutionnelles.
Assainissement, eau et inondations : vulnérabilités environnementales
L’urbanisation non planifiée accroît la vulnérabilité aux inondations : occupation de sites sensibles, insuffisance des réseaux d’évacuation des eaux pluviales et dépôts sauvages. Des études récentes, dont l’étude « Urbanization Impacts on Wetland Ecosystems in Northern Municipalities of Lomé (Togo): A Study of Flora, Urban Landscape Dynamics and Environmental Risks », soulignent l’impact de l’urbanisation sur les zones humides et les écosystèmes littoraux de Lomé, avec des répercussions directes sur la santé publique (maladies hydriques) et la résilience urbaine. Les autorités s’appuient sur des projets nationaux et programmes de la Banque mondiale pour développer des plans d’assainissement et de gestion de l’eau urbains.
Santé et éducation : services sous tension
L’afflux de population se traduit par des salles de classe surchargées, des structures sanitaires mises à l’épreuve et un besoin accru en personnel qualifié. Les villes concentrent davantage d’établissements, mais la capacité n’évolue pas au même rythme que la demande, ce qui crée des inégalités d’accès selon le revenu et le statut (résidents formels vs habitants informels). Les acteurs internationaux (Banque mondiale, ONU) et ONG soutiennent des programmes pour renforcer l’accès aux services de base.
Emploi : formalisation difficile et essor de l’informel
La majorité des nouveaux arrivants se retrouvent dans l’économie informelle : commerce de rue, petits métiers, transport informel. L’absence de qualification ciblée, l’insuffisance des formations professionnelles locales et la rareté d’emplois formels poussent la capitale à absorber une main-d’œuvre souvent précaire. Le risque : reproduction des vulnérabilités sociales en milieu urbain (chômage, sous-emploi). Des programmes de formation et d’insertion sont préconisés pour mieux connecter offre et demande.
Environnement et patrimoine : tensions entre développement et conservation
La pression sur le foncier et la construction rapide menace parfois le patrimoine architectural et les espaces verts. Des débats récents (comme celui sur la restauration du Palais de Lomé vs. d’autres bâtiments historiques) illustrent la difficulté de concilier modernisation et préservation culturelle face à une urbanisation accélérée.
Ce que font les autorités et les partenaires : plans, projets et limites
Plusieurs initiatives montrent que l’État et ses partenaires savent que Lomé doit se réinventer pour rester vivable. On a entre autres :
Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme (SDAU) pour le Grand Lomé : finalisation en cours pour mieux organiser l’expansion urbaine et planifier les infrastructures.
Projets soutenus par la Banque mondiale pour le développement urbain, la planification et l’assainissement (projets documentés par la Banque mondiale).
SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) : élaboration d’une stratégie mobilité pour réduire la congestion et renforcer la gouvernance des transports.
Capacités institutionnelles : actions UNDP/ONUs et programmes nationaux intégrés au PND et feuille de route 2020–2025.
Ces réponses sont de bonne volonté, mais la mise en œuvre reste contrainte par des ressources limitées, la complexité foncière, et l’urgence sociale.
Recommandations pratiques pour une adaptation durable
Il faut accélérer la finalisation et l’application du SDAU du Grand Lomé (zoning, réserves foncières pour logements sociaux, protection des zones à risques).
Déployer rapidement des solutions d’assainissement et de gestion des eaux pluviales (plans directeurs d’assainissement) pour réduire l’exposition aux inondations.
Renforcer le SUMP et la gouvernance des transports : prioriser transports publics, pistes cyclables et réglementation des mototaxis.
Investir dans la formation professionnelle et l’accès au financement pour formaliser les activités économiques urbaines.
Lomé se transforme sous la pression d’un afflux continu d’habitants venus des campagnes et d’ailleurs. Les défis, logement, mobilité, assainissement, services sociaux, sont connus et des plans existent. La clé, désormais, est l’accélération de la mise en œuvre, la coordination entre acteurs (État, communes, bailleurs, société civile) et la mobilisation de ressources durables pour que la croissance urbaine devienne synonyme d’inclusion et de résilience, et non d’inégalités et de vulnérabilité accrues.


