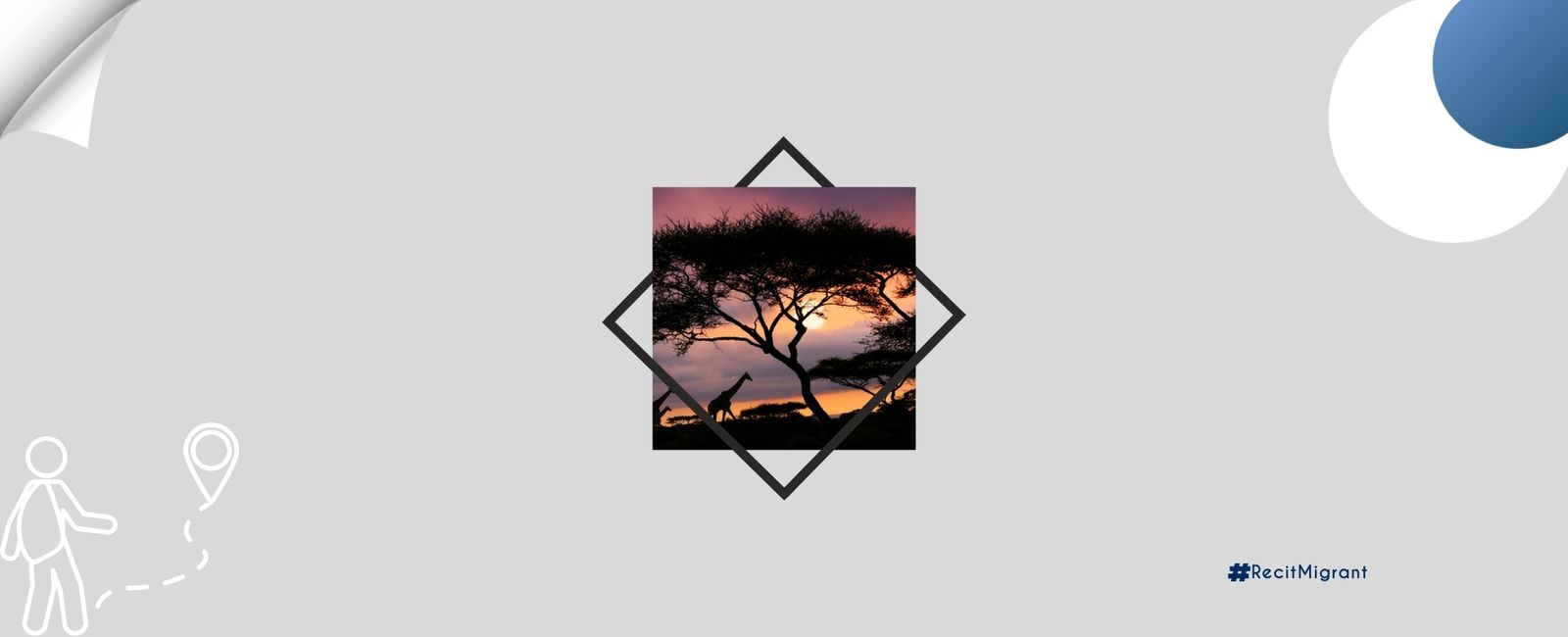
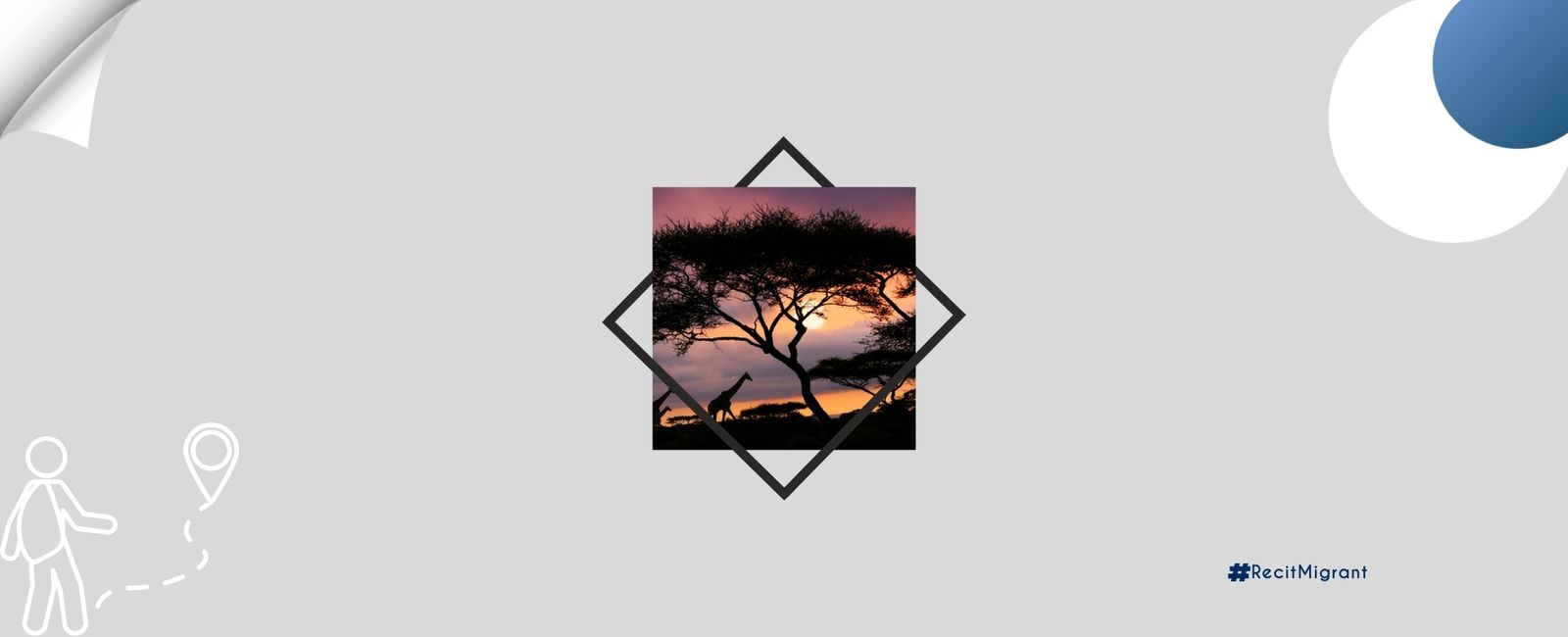
Dans un contexte où les migrations africaines sont souvent mal comprises, le concept de migration circulaire apporte un nouvel éclairage : il met en avant la logique d’échanges, d’allers-retours et de résilience qui caractérise les mobilités sur le continent. Du Sénégal au Togo, cette dynamique s’affirme comme un véritable modèle africain de mobilité durable.
Le concept de « migration circulaire » désigne les déplacements répétés ou à durée limitée de personnes entre un pays d’origine et un ou plusieurs pays de destination, avec un retour (temporaire ou plus durable) puis souvent un nouveau départ. Selon la définition de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) : « le déplacement de personnes entre différents pays, y compris les mouvements temporaires ou permanents, qui, dès lors qu’il se produit de manière volontaire en lien avec les besoins en main-d’œuvre des pays d’origine et de destination, peut être bénéfique pour toutes les parties concernées. »
En contexte africain, ce modèle de mobilité renvoie non seulement à des migrations Sud-Nord, mais surtout à des mobilités intra-africaines, temporaires, répétées, souvent en lien avec des réseaux familiaux, économiques ou environnementaux. Cette circulation peut être vue comme une forme d’« installation de la mobilité » plutôt que d’installation permanente. Elle questionne la distinction classique entre émigration fixe et immigration fixe.
Pourquoi ce modèle est-il particulièrement pertinent en Afrique ?
Une forte mobilité intra-continentale
80 % des migrations africaines se font entre pays africains. Les flux régionaux (par exemple au sein de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest — CEDEAO) sont structurés depuis des décennies.
Réseaux de solidarité et de retour
Au Sénégal, par exemple, l’étude « La migration circulaire des Sénégalais » montre que 1 migrant sur 4 est revenu dans son pays après environ 5 années à l’étranger, et parmi eux 17 % ont de nouveau quitté le pays après retour.
Une réponse aux besoins de main-d’œuvre et de compétences
La migration circulaire peut apporter aux pays d’origine des transferts de compétences, d’argent, d’expériences acquises à l’étranger ; pour les pays de destination, elle peut répondre à des besoins de main-d’œuvre saisonnière ou spécialisée.
Adaptation aux défis environnementaux et économiques
Comme l’indique le site de « Institute for Security Studies (ISS Africa) », les protocoles de libre circulation favorisent les migrations transfrontalières circulaires et saisonnières. Ce qui permet aux migrants de rentrer chez eux avec transferts, compétences et réseaux.
Quelques exemples en Afrique
- Sénégal–Espagne : Un mémorandum d’entente signé en 2021 entre le Sénégal et l’Espagne vise à promouvoir la migration circulaire, en facilitant le départ temporaire de Sénégalais afin de répondre à des besoins de main-d’œuvre espagnole tout en assurant un retour.
- Afrique de l’Ouest (Sahel central) : Selon une étude sur le Sahel central, les migrations intra-régionales fonctionnent comme des régimes de mobilité circulaire, avec retours fréquents, mobilités multiples entre pays.
Avantages et défis
Avantages
- Pour le migrant : accumulation de compétences, revenus à l’étranger, maintien de liens avec le pays d’origine.
- Pour le pays d’origine : retour de compétences, investissement des migrants, renforcement des réseaux transnationaux.
- Pour le pays de destination : complément de main-d’œuvre, flexibilité, échanges culturels.
Défis
- La circularité ne se fait pas toujours de façon équitable : risque d’exploitation, contrats précaires, absence de protection sociale.
- Le retour n’est pas systématique ou ne se fait pas dans des conditions optimales. L’étude sénégalaise note que le retour rapide est plus fréquent pour des migrations intra-Afrique qu’à destination du Nord.
- Faible reconnaissance institutionnelle : les politiques migratoires ne prennent pas toujours en compte les mobilités circulaires comme type à part entière.
- Infrastructure de soutien insuffisante dans de nombreux pays : données, suivi, intégration, protection.
Conditions pour que la migration circulaire soit « un modèle de développement »
Pour que la migration circulaire soit bénéfique, plusieurs conditions sont nécessaires.
Il faut que des accords ou cadres institutionnels entre pays d’origine et destination qui reconnaissent la circularité, assurent des droits et des retours dignes.
Egalement, il faut une intégration au plan de développement local, que le retour, les compétences et les investissements soient articulés avec les politiques nationales.
Il faut une protection des migrants à travers les droits fondamentaux, l’accès à la santé, aux services, aux conditions de travail décentes.
Le dialogue politique doit s’appuyer sur des données fiables. Le rapport de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) sur la migration en Afrique note l’importance de renforcer la coordination des données de mobilité.
Implications pour le contexte ouest-africain et continental
Le modèle de migration circulaire peut être particulièrement adapté à l’Afrique de l’Ouest, où la libre circulation est un principe de la CEDEAO, et les distances, les réseaux et les langues facilitent la mobilité. Le lancement en 2025 de la Stratégie de migration de main-d’œuvre de la CEDEAO conforte cette orientation.
Par ailleurs, le modèle offre une alternative à la « fuite des cerveaux » ou à l’émigration permanente massive. En favorisant les allers-retours et le maintien de relations avec le pays d’origine, il permet de mieux tirer parti des dynamiques de la diaspora, des compétences et des investissements transnationaux. Le rapport de la Banque Africaine de Développement et de l’IOM insiste sur cette dimension “skills mobility” comme levier de développement.
Limites et perspectives
Malgré les bénéfices attendus, ce modèle reste encore trop peu institutionnalisé en Afrique. Les programmes sont souvent limités à quelques accords bilatéraux (ex. Sénégal-Espagne) et la majorité des flux circulaires n’entrent pas dans des cadres formalisés. De plus, la sécurité, la protection sociale, et la reconnaissance des droits des migrants restent des défis majeurs.
À l’avenir, renforcer la coopération régionale, améliorer la gouvernance des mobilités et garantir que les retours ne se traduisent pas par une « réinstallation forcée », mais par une réelle inclusion sociale et économique sera indispensable.
En Afrique francophone de l’Ouest, ce modèle offre une alternative intéressante à l’émigration permanente et à l’installation à l’étranger. Il permet de penser la mobilité comme un jeu d’échanges, de ressources et de compétences. Toutefois, pour que cette vision se réalise, il faut des politiques migratoires audacieuses, des protections renforcées et une reconnaissance pleine de la migration circulaire.


